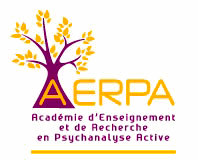L’analyse didactique de formation
Le parcours de formation pour devenir psychanalyste s’ancre dans un socle de base qu’est l’analyse didactique de formation. L’analyse didactique, analyse personnelle menée dans le but de devenir psychanalyste est conduite par un psychanalyste-formateur. Devenir psychanalyste est le nom de la formation créée par l’AERPA. Ce « devenir psy » commence toujours par un cheminement personnel et intérieur, une maturation intime, un développement des compétences d’écoute et de distance. Il est nécessaire d’avoir d’abord éprouvé pour soi et en soi, les remous de la thérapie psychanalytique et les fluctuations transférentielles avant de s’engager dans cette formation.
« La formation est avant tout un chemin vers soi, pour mieux comprendre l’autre. »(*)
La formation de l’AERPA avec la méthode de la Psychanalyse Active permet de développer une capacité d’écoute de son propre inconscient, ouverture nécessaire pour savoir écouter cette dimension chez un autre. « Devenir psychanalyste » est un parcours personnel à mener, un temps consacré à l’étude de l’inconscient, individuel et collectif, une dimension de soi à ouvrir et épanouir, concrétisant le désir d’accompagner autrui sur le chemin vers lui-même.
Historique
La formation du psychanalyste a toujours été une préoccupation importante sujette à de nombreux questionnements déontologiques. Freud lui-même s’est formé en pratiquant une auto-analyse : son premier ouvrage publié « l’analyse des rêves » est le récit de cette introspection . A partir de ses rêves, il a pratiqué des libres associations de souvenirs qu’il a analysés.
Ses amitiés fortes, notamment la première, avec son ami médecin Wilhem Fliess, de même celle qu’il eut avec C.G.Jung avant leur rupture, ainsi que la relation instaurée avec S.Ferenczi, et d’autres, se sont révélées être, pour lui, des miroirs transférentiels à partir desquels il a pu se former aussi, apprendre à mieux se connaître. Ces relations étaient empreintes d’un relationnel parfois complexe, de disciple à maître, disciples d’abord dans un rapport d’admiration et de soumission, puis d’émancipation.
Freud a formé lui-même les futurs psychanalystes qui furent ses disciples, en les analysant. Ensuite, l’apprentissage du métier de psychanalyste s’est maintenue sous cette forme de transmission d’expérience. Le vécu analytique ne peut s’apprendre dans les livres, il doit être expérimenté dans une cure.
Freud a clairement exprimé qu’il n’était point besoin d’être médecin pour être psychanalyste, et a œuvré pour préserver l’indépendance de la psychanalyste par rapport aux autres sciences humaines.
Définition
L’analyse didactique est le terme employé pour définir le parcours analytique du futur psychanalyste.
« Il s’agit essentiellement d’une analyse destinée à éclairer le sujet sur lui-même, sur ses réactions inconscientes, et , surtout, à lui faire comprendre, en les vivant, les difficultés et les ressorts de la psychanalyse, en particulier les résistances à la cure et le transfert. »(**)
Le futur analyste doit avoir vécu lui-même les secousses de l’analyse. Il doit s’être compris le mieux possible, afin de pouvoir comprendre l’autre, et projeter le moins d’affects possibles dans les prochaines relations contre-transférentielles qu’il aura à gérer.
L’analyse personnelle est la base de toute formation à la profession de psychanalyste.
Il s’agit d’une analyse effectuée dans un cadre didactique, c’est-à-dire qui est une préparation au futur métier de psychanalyste.
Freud, dans une conférence datant de 1912 :
« Non seulement l’analyse didactique permet au futur analyste d’apprendre à connaître bien plus rapidement et avec une moindre dépense en affect, tout ce qui est caché en lui, mais encore il acquiert des impressions et des convictions qu’aucun ouvrage, aucune conférence n’eussent été capables de lui donner. »
Le future analyste doit avoir vécu le passage par les étapes déstructurantes de son propre cheminement analytique, puis l’étape de construction qui suit l’analyse.
On forme un inconscient analytique : c’est l’instrument du psychanalyste qui doit être travaillé. Par l’écoute, les questionnements personnels, les prises de conscience, le regard introspectif, le travail sur les peurs et les désirs.
La prise de risque de la relation analytique possède un rôle pédagogique : une bonne formation permet de s’y préparer et conduit à l’élaboration psychique de la présence et de l’écoute analytiques.
On ne pourrait accompagner un analysant dans sa propre exploration psychique faite d’avancées, de résistances, de régressions si l’on n’avait pas soi-même vécu et surmonté les mêmes difficultés.
« L’analyse didactique constitue une phase indispensable et décisive dans la formation du candidat, car un psychanalyste ne peut espérer comprendre ses patients que s’il s’est compris lui-même. »(***)
Bibliographie :
(*) Geneviève Abrial: enfin moi! votre psychanalyse active, Éditions Puf, collection psychoguides
(**) Norbert SILLAMY : Dictionnaire usuel de psychologie, Éditions Bordas
(***) Laplanche et Pontalis : Dictionnaire de la psychanalyse, Éditions Puf